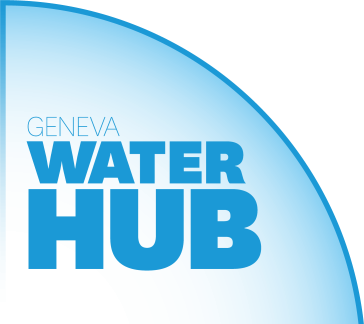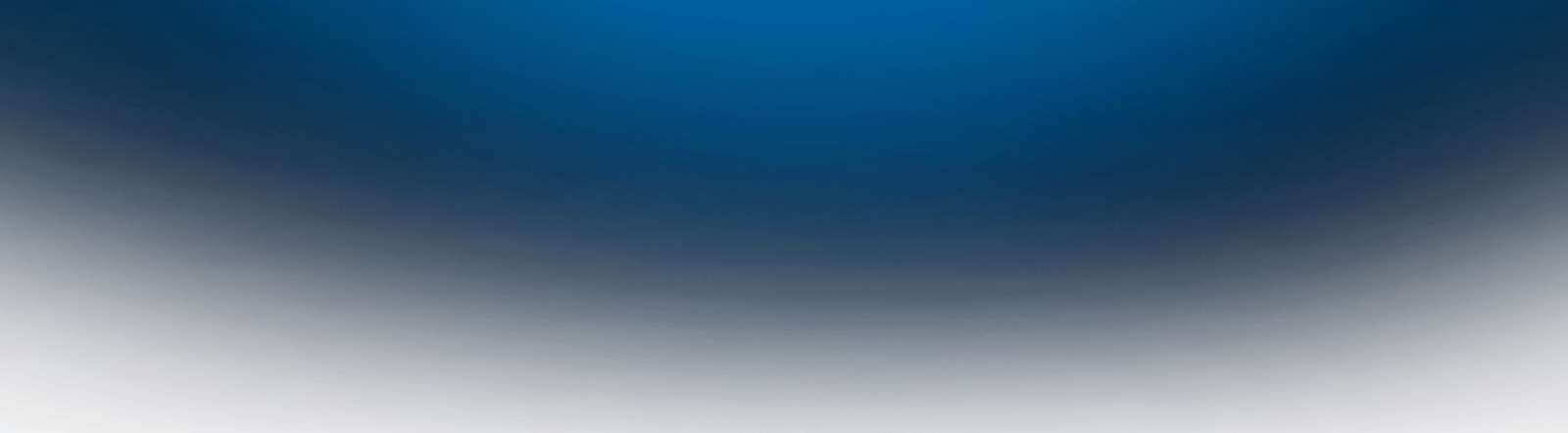
L'Observatoire mondial de l'eau et de la paix

Contexte
Le monde est confronté au drame de l'eau. Quelque deux milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. De plus, 40 % de la population mondiale vit dans des bassins où les rivières et les aquifères sont partagés par différents pays et représentent des zones de conflit potentiel. Dans les conflits armés contemporains, les ressources et les installations hydrauliques sont de plus en plus souvent attaquées et utilisées comme armes de guerre. En outre, la pénurie d'eau est exacerbée dans un monde où une population croissante est confrontée au changement climatique résultant de l'activité humaine. D'ici le milieu du siècle, près de quatre milliards de personnes (environ 40 % de la population mondiale) vivront dans des bassins soumis à un stress hydrique. Ce chiffre devra probablement être revu à la hausse à mesure que les effets du changement climatique s'accentueront, entraînant une baisse des rendements, des sécheresses, des inondations et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Ces effets seront ressentis dans le monde entier, mais leur impact plus important sur la sécurité alimentaire et le déplacement des populations vulnérables touchera d'abord les pays en développement. Les migrations et l'urbanisation incontrôlée qui en résulte exacerberont la pression sur des ressources en eau déjà limitées.
Face à ces problèmes, l'humanité devra trouver le moyen de réduire de moitié sa production alimentaire dans les 25 prochaines années et de doubler sa production d'énergie d'ici le milieu du siècle. Ses activités nécessiteront des ressources en eau considérables pour satisfaire non seulement les besoins d'une population toujours croissante, mais aussi pour maintenir des conditions environnementales favorables au fonctionnement des écosystèmes. La rareté de l'eau accroît la concurrence entre les besoins des différentes utilisations de l'eau, notamment la consommation humaine, l'industrie, la production d'énergie et l'environnement. Cela conduit inévitablement à des tensions entre les utilisateurs, voire entre différents secteurs, entre les différents utilisateurs d'un bassin hydrographique ou entre différents États.
L'eau est au cœur du lien entre l'énergie, la santé, l'agriculture et la biodiversité. Les crises auxquelles la planète est confrontée se chevauchent et se recoupent, et nous ne pouvons pas nous permettre de les résoudre une à une de manière isolée. Mais en nous concentrant sur ce qui les relie - l'eau et son objectif de développement durable n° 6 - nous pouvons progresser dans d'autres domaines. À l'inverse, ignorer le rôle du lien joué par l'eau rendra impossible la réalisation des autres objectifs de développement durable.
La sécurité de l'eau nécessite donc une collaboration interdisciplinaire entre différents secteurs, communautés et pays. La coopération internationale est donc d'une importance vitale. Ce constat est d'autant plus frappant qu'il a été démontré que deux États collaborant activement à la gestion d'une ressource en eau partagée ne se font pas la guerre, quelle qu'en soit la raison. Par conséquent, il est crucial de reconnaître l'importance et la nature politique d'un grand nombre de questions liées à l'eau qui doivent être traitées de manière diplomatique, nécessitant ainsi une attention qui va au-delà de la coopération technique dans le domaine de l'eau.
Introduction
L'eau est l'un des domaines clés de notre avenir commun, et la coopération internationale dans le domaine de l'eau est donc un impératif. Cependant, le niveau actuel de la coopération internationale dans le domaine de l'eau laisse beaucoup à désirer. En outre, les problèmes liés à l'eau sont de plus en plus au cœur des conflits armés de notre époque, une tendance qui rappelle de manière dramatique le lien fondamental entre l'eau, la sécurité et la paix.
Ces considérations ont conduit un groupe de quinze États membres des Nations unies à initier la création du Panel mondial de haut niveau sur l'eau et la paix. Le Panel a été lancé lors d'une réunion ministérielle à Genève le 16 novembre 2015. Les travaux du Panel ont été soutenus par le Geneva Water Hub, une organisation suisse qui a assuré le secrétariat.
Le rapport du Panel est le fruit des réflexions de huit tables rondes d'experts sur des sujets de pointe ainsi que de consultations avec des centaines de décideurs politiques et d'experts du monde entier. Après quatre réunions de travail organisées sur différents continents, le groupe d'experts a présenté son rapport final fin 2017 à Genève, à New York et lors d'événements mondiaux et régionaux.
Le groupe a conclu que le défi mondial de l'eau ne concerne pas seulement le secteur du développement et les droits de l'homme, mais aussi la paix et la sécurité. Il est donc urgent d'accorder une attention particulière au lien entre l'eau, la paix et la sécurité et de l'aborder de manière intégrée et globale à tous les niveaux, ce qui nécessite une réponse en termes de nouvelles réflexions, de nouvelles pratiques et de nouvelles institutions dans les domaines de la diplomatie, du droit international, de la gestion des données, des finances, de la gestion de la sécurité, de la technologie, des migrations, du changement climatique et de la lutte contre la pollution, entre autres.
Le groupe a présenté une série de recommandations concrètes d'action dans ce sens, qui doivent maintenant être mises en œuvre avec le soutien des États et des organisations désireux de s'engager dans l'agenda pour l'avenir de l'eau, de la paix et de la sécurité. L'une de ces recommandations appelle à la création d'un Observatoire mondial de l'eau et de la paix.
Le raisonnement derrière l'Observatoire mondial de l'eau et de la paix
De nombreux organismes et mécanismes existants contribuent de manière significative à la coopération dans le domaine de l'eau, dans la mesure où le niveau actuel de la coopération internationale le permet. Cependant, une caractéristique importante des discussions relatives à la coopération internationale dans le domaine de l'eau est la capacité limitée des acteurs internationaux à agir collectivement et efficacement aux niveaux politique et diplomatique et la recherche d'un foyer mondial d'hydro-diplomatie.
Le rôle du GOWP, en tant que plateforme mondiale, est de faciliter l'assistance aux parties intéressées en utilisant l'eau comme instrument de coopération, en évitant les tensions et les conflits, et en promouvant la paix. Le GOWP adopte une approche de gestion des connaissances et de facilitation discrète plutôt que les approches traditionnelles de règlement des différends, de rétablissement de la paix ou de construction de la paix.
Le rôle de l'Observatoire mondial de l'eau et de la paix
Le GOWP, en tant que plateforme mondiale, disposera de solides capacités analytiques en matière d'eau, de paix et de sécurité. L'objectif de l'Observatoire sera de catalyser et de faciliter l'expansion de la coopération sur l'eau pour la paix, en se concentrant sur l'hydro-diplomatie au-delà de la gestion conjointe, et en coopération avec ses partenaires de mise en œuvre, en.. :
- Recueillir les meilleures pratiques et les enseignements tirés sur l'eau et la paix et tenir à jour une liste d'experts provenant d'organisations praticiennes afin de canaliser l'expertise là où elle est nécessaire ;
- Contribuer à développer l'analyse des alertes précoces, des problèmes susceptibles d'entraîner des conflits, et aider à renforcer la confiance en proposant des solutions pacifiques.
- Faciliter la formation et le développement des compétences en matière de diplomatie de l'eau ;
- Fournir un "espace sûr" pour les consultations de pré-négociation à un stade précoce du développement du projet, ou pour aborder de manière proactive les principales questions de mise en œuvre ; l'espace sûr en tant qu'approche ou "concept" sera fourni par le GWOP et facilité par les partenaires de mise en œuvre régionaux/locaux, avec un soutien et un renforcement des capacités fournis par le Secrétariat du GWOP et son réseau d'experts, en s'appuyant en particulier sur les ressources de la Genève internationale, sur les thèmes de l'infrastructure partagée à grande échelle, des conflits intersectoriels au niveau local, et dans les zones fragiles/conflictuelles, en collaboration avec les organisations humanitaires et de sécurité.
- Agir en tant que catalyseur de l'investissement financier dans la coopération dans le domaine de l'eau afin d'attirer le financement du secteur privé, en liaison avec le Fonds bleu proposé, y compris le financement d'amorçage des vérifications de faisabilité initiales et des idées de coopération,
- assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations du groupe d'experts et rédiger un rapport annuel.
"Open Science, leaving no one behind" et l'Observatoire mondial de l'eau et de la paix
Le 10 novembre a marqué la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Le thème de 2019 est "Une science ouverte, qui ne laisse personne de côté".
La science ouverte est la science traditionnelle menée de manière plus transparente et collaborative, et vise à offrir des chances égales à tous en termes d'accès à la science, aux connaissances et aux données.
Le thème de cette année, la science ouverte, ne concerne pas seulement les universitaires, mais tous ceux qui contribuent au développement durable, à l'atténuation de la fragilité et au renforcement de la résilience de notre monde moderne.
Ces dernières années, le potentiel de la coopération dans le domaine de l'eau en tant que vecteur de paix a été de plus en plus reconnu au niveau mondial. Le potentiel du lien entre l'eau et la paix est également de plus en plus apprécié ; une paix qui n'est pas définie par l'absence de conflit armé, mais par la prévalence d'un développement durable.
Il y a deux ans, le groupe mondial de haut niveau sur l'eau et la paix a publié son rapport intitulé "Une question de survie", qui contient une série de recommandations visant à renforcer le cadre mondial de prévention et de résolution des conflits liés à l'eau, à faciliter l'utilisation de l'eau en tant que facteur important dans la construction de la paix et à renforcer la pertinence des questions liées à l'eau dans l'élaboration des politiques nationales et mondiales.
Parmi ces recommandations, figure la création de l'Observatoire mondial pour l'eau et la paix, un réseau inclusif qui améliore la capacité limitée des acteurs internationaux à agir collectivement et efficacement aux niveaux politique et diplomatique pour combler les lacunes critiques de l'architecture mondiale de l'eau dans sa capacité à contribuer à la réalisation de l'Agenda 2030 et à "ne laisser personne de côté".
L'Observatoire mondial de l'eau et de la paix est un exemple de plateforme scientifique ouverte qui fournit des connaissances et partage l'expertise à tous, sur le potentiel et le rôle de l'hydrodiplomatie à des fins de paix et de développement. Il s'agit d'une approche innovante et affinée des pratiques existantes, destinée à créer un réseau ouvert d'expertise (individuelle et institutionnelle). La capacité d'analyse de l'Observatoire mondial de l'eau et de la paix et de ses partenaires régionaux est renforcée par des données étayées et des preuves scientifiques, grâce à la recherche et à la science ouverte.
En outre, l'Observatoire mondial de l'eau et de la paix vise à promouvoir une "diplomatie populaire" qui inclut des acteurs aux niveaux local, national et régional. L'expression "ne laisser personne de côté" ne s'applique pas seulement à une science ouverte qui inclut également les personnes marginalisées et fragiles, mais s'étend également à un autre droit humain fondamental : le droit à l'eau et à l'assainissement. L'Observatoire mondial de l'eau et de la paix vise à ne laisser personne de côté dans le processus d'utilisation de l'eau comme vecteur de paix.